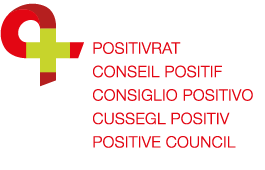Actuel
- Détails
- Catégorie : Organisation
Le Conseil Positif est un comité de défense des intérêts des personnes atteintes du VIH. Ses compétences couvrent notamment les domaines de la santé, du droit, du lobbying et de la communication. Le Conseil Positif est en contact étroit avec l’Aide Suisse contre le Sida (ASS). Néanmoins, ses prises de position ne sont pas nécessairement celles de l’ASS.
Le Conseil Positif est composé de personnes atteintes du VIH, de personnes de leurs familles ou de spécialistes dans les domaines susmentionnés qui se solidarisent avec elles. Ses membres possèdent des connaissances professionnelles ou personnelles et de l’expérience dans le domaine médical, sanitaire et social, psychosocial, politique ou en matière de communication.
Président: Walter Bärtschi
Vice-Président: David Haerry
Secrétariat: Walter Bärtschi
Code
- Le travail technique et politique du Conseil Positif s’inscrit exclusivement dans le cadre des objectifs qui sont les siens, dans le respect de la législation en vigueur. Son action est dénuée de tout intérêt commercial ou corporatiste et indépendante d’autres organisations du monde politique et économique.
- La collaboration avec d’autres entreprises ou institutions doit toujours servir les objectifs susvisés.
- Le travail du Conseil Positif doit être documenté, transparent et vérifiable. Cela vaut également pour les accords conclus avec des partenaires de coopération tels que l’industrie pharmaceutique.
- Le Conseil Positif appréhende ouvertement et sans préjugés les nouvelles idées et approches en matière de recherche, si elles sont susceptibles d’améliorer la prise en charge médicale ou les conditions de vie en général des personnes porteuses du VIH.
- S’il bénéficie d’un soutien financier de la part de personnes privées, d’entreprises et de pouvoirs publics, le Conseil Positif veille à ce que la disparition de ces aides ne nuise pas à sa pérennité.
- Le Conseil Positif reconnaît la diversité des personnes atteintes du VIH et de leurs défenseurs et respecte dans ses décisions les différents facteurs personnels tels que l’âge, la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la position sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Les membres du Conseil Positif s’engagent à faire preuve de respect les uns envers les autres.
Mission Statement
Positivrat Schweiz Mission Statement.pdf
Statuts
Positivrat Schweiz Statuten.pdf
- Détails
- Catégorie : Divers
Le terme de chemsex (connu aussi comme «Party and Play» abrévié PNP) désigne une pratique de la sous-culture MSM qui consiste à avoir des rapports sexuels sous l’influence de substances psychoactives. Cette pratique a pour la première fois fait l’objet d’une étude approfondie, l’étude Chemsex, menée dans certains quartiers de Londres comme Lambeth, Southwark et Lewisham 1.
On trouve des scènes de chemsex similaires dans d’autres grandes métropoles européennes, mais elles sont moins connues que celle de Londres. Le chemsex se pratique par exemple dans les sexclubs, saunas, backdoors mais aussi — sur rendez-vous pris via des sites de rencontre — dans des salles privées. Des apps facilitent prise de contact, mais aussi vente de drogue, depuis le Smartphone. Les participants sont généralement des MSM de 20 à 60 ans. La tranche d’âge la plus représentée est celle des 30 à 50 ans.
Des substances stimulantes et désinhibantes
Sont utilisées dans la plupart des cas des substances psychoactives telles que cristal meth (méthamphétamine), GHB/GBL (acide gamma hydro butyrique, resp. gamma butyrolactone), méphédrone 2 (4-méthylméthcathinone) et dans une moindre mesure, cocaïne et kétamine. Toutes ces substances – hormis la kétamine – ont un effet stimulant, augmentent la pression artérielle, accélèrent la fréquence cardiaque et génèrent une sensation euphorique et désinhibante. Elles renforcent également chez certaines personnes l’excitation sexuelle et induisent une tendance à prendre plus de risque. L’influence de ces drogues désinhibantes se traduit souvent par l’acceptation de rapports sexuels non protégés et avec des partenaires divers pouvant se prolonger des heures durant, voire tout un week-end. Et comme ces substances tendent à inhiber l’érection, des stimulateurs tels que le viagra sont souvent pris en parallèle. Les poppers 3 sont à présent des drogues standards (plutôt inoffensives) et ne sont donc pour cette raison pas mentionnées dans l’étude.
Conséquences physiques, psychiques et sur la vie (amoureuse)
La consommation régulière de substances psychoactives génère des dommages somatiques et psychiques irréversibles. L’effet désinhibant de ces substances s’accompagne d’une augmentation du risque de transmission du VIH et de l’hépatite C ou d’autres infections sexuellement transmissibles. A quoi s’ajoutent les risques de surdosage (lors de mélanges de différentes drogues également), de dépendance et d’autres conséquences négatives sur la santé. Le spectre s’étend des troubles physiques et psychiques aux problèmes sociaux et interpersonnels pouvant impacter négativement la vie sociale et la dynamique relationnelle, dans les sphères tant privée que professionnelle. Dépression, paranoïa, angoisses, agressivité, crises de panique, crampes et perte de connaissance en sont souvent les conséquences. On déplore même à ce jour quelques décès. Ce phénomène va de pair avec un vaste marché de production et de distribution des drogues utilisées, interdites dans la plupart des pays. Les doutes fréquents concernant leur qualité et leur pureté sont liés à des risques supplémentaires pour l’utilisateur.
Il est difficile, une fois habitué à des pratiques sexuelles sous les effets de la drogue, de trouver une satisfaction avec d’autres pratiques. Le sexe sous l’influence de drogues psychoactives tient plus chez certains à un défoulement instinctif qu’à un plaisir partagé contrôlé et agréable. Il faut à ceux qui cessent de prendre ces drogues un an au moins, avec une psychothérapie, pour espérer retrouver une vie sexuelle plus ou moins normale.
Si certains rapports parlent de bombe à retardement, d’autres incitent à la modération et mettent en garde contre les dangers d’un alarmisme exacerbé. Certains éléments indiquent déjà que le chemsex, comme toute autre pratique sexuelle à risque, pourrait avoir pour effet une nouvelle augmentation du nombre d’infections VIH dans la population MSM. On craint en outre que les adeptes de cette pratique ne ruinent leur vie à long terme. Il a déjà été constaté une hausse des co-infections VIH et hépatite C : 7 pour cent des personnes infectées par le VIH à Londres sont co-infectées 4. La PrEP offre certes une protection contre une contamination au VIH, mais pas contre le hépatite C et les autres maladies sexuellement transmissibles.
Les métropoles: des zones particulièrement sensibles
Si la pratique du chemsex – notamment sous cristal meth et méphédrone – s’est d’abord étendue à Londres, des scènes similaires se sont développées dans d’autres métropoles européennes en même temps que la culture gay. La Suisse ne fait pas exception. Selon une étude de Deutsche AIDS-Hilfe 5, Zurich se place au milieu du classement des métropoles européennes en termes de consommation de GBL/GHB, kétamine, méphédrone ou cristal meth (listées ci-dessous par ordre décroissant):
1. Manchester
2. Londres
3. Amsterdam
4. Barcelone
5. Zurich
6. Madrid
7. Berlin
8. Paris
9. Bruxelles
10. Cologne/Bonn
11. Vienne
12. Rome
En termes de consommation de cocaïne, Zurich vient en troisième position après Anvers et Amsterdam, Bâle et Genève occupent respectivement les rangs 9 et 10. L‘ecstasy est également fréquemment consommée en Suisse, tandis qu’amphétamines et cristal meth sont plutôt évités 8. Selon l’étude britannique, la consommation est de deux à quatre fois plus élevée dans les soirées sexuelles privées que dans les soirées sexuelles publiques 3. L’étude ne précise pas quelles drogues sont consommées où. Les relevés des eaux usées des agglomérations fournissent aujourd’hui des indications sur l’utilisation des substances psychoactives dans les villes concernées 6. Les relevés mettent à jour une consommation d’ecstasy 4 fois plus importante le week-end que les autres jours de la semaine. En Suisse, la région de Neuchâtel se place par exemple étonnamment en première position pour la consommation de cristal meth, suivie par les villes de Zurich, Bâle, Berne, Winterthur, St. Gall et Lausanne 7.
Le chemsex s’impose comme la pratique «à suivre»
Dans une perspective socio-psychologique, le sentiment d’isolement et de moindre estime de soi joue certainement un rôle. Cette pratique est aussi souvent liée à une homophobie internalisée et un comportement d’addiction incontrôlé – pour l’alcool et le tabac également. Cela conduit beaucoup de gays à fréquenter des lieux où se pratiquent les rapports sexuels anonymes et les mène souvent à une addiction à la drogue, dont ils ne peuvent sortir sans une aide extérieure. Un élément problématique est notamment le fait que dans ces soirées à caractère sexuel, le chemsex s’impose de plus en plus comme la pratique «à suivre» et que les participants se retrouvent poussés, par la pression du groupe, à consommer de la drogue. D’autres causes sont l’exclusion sociale, malheureusement toujours d’actualité, des gays, mais aussi une mutation de la culture gay. Autrefois, les bars et clubs gay étaient généralement avant tout un lieu de rencontre avec d’autres hommes, on échangeait et après seulement — s’il existait un minimum d’affinités et que les profils se correspondaient — on passait à l’acte. Aujourd’hui, dans les saunas, backrooms et sexclubs, on passe immédiatement à l’acte de manière anonyme et instinctive. Les drogues psychoactives empêchent ensuite toute rencontre humaine, alors même que c’est ce que la plupart recherchent à la base.
L’effet à long terme n’est pas «satisfaisant»
L’étude chemsex fait une description marquante des effets sur les utilisateurs: «Une majorité des hommes souffraient de problèmes d’estime de soi ou de confiance en soi sur le plan sexuel et rapportaient pouvoir surmonter (ou du moins dissimuler) ces problèmes de drogue. Si la plupart des participants indiquaient que les drogues augmentaient l’excitation ou l’appétit sexuels, certains mentionnaient y recourir régulièrement parce qu’il leur était difficile, voire impossible, d’avoir un rapport sexuel sans ces substances 6.» L’étude montre que les drogues peuvent exacerber l’expérience sexuelle et permettre d’établir le contact avec d’autres hommes, même si l’effet n’est souvent que de courte durée. La consommation de drogue permet de plus des rapports sexuels de plus longue durée, et ouvre ainsi la possibilité à des relations avec plusieurs hommes ou sur une période plus longue, de même que des pratiques plus variées ou plus osées. Ceux des participants qui choisissent l’injection de drogue, notamment de cristal meth, rapportent que ce type de consommation ouvre la voie à des pratiques sexuelles encore plus extrêmes que d’autres formes d’ingestion. L’étude met également à jour le revers de la médaille du chemsex: «Si la plupart des participants indiquent apprécier l’aventure sexuelle, certains hommes mentionnent leur inquiétude d’avoir outrepassé leurs limites sexuelles et regrettent leur comportement. Bien que la consommation de drogue rehausse l’expérience sexuelle à différents niveaux, la plupart des hommes ont avoué être insatisfaits de leur vie sexuelle. Nombreux sont ceux qui souhaitent une relation à long terme, qui leur permettrait une relation sexuelle plus intime et plus émotionnelle, et jugent que la consommation de drogue ou le contact étroit avec des réseaux d’hommes pratiquant le chemsex ne peuvent y mener 9.»
Approches pratiques de prévention
Il est nécessaire d’informer clairement ceux qui le pratiquent des conséquences du chemsex. Les auteurs de l’étude recommandent toutefois de renoncer à une campagne de marketing social sur les dangers du chem¬sex (ni au niveau du Lambeth, Southwark, Lewisham ni à Londres ou à l’échelle du pays) 9. Très peu des défis liés à ce projet sont susceptibles de trouver une réponse adéquate dans une approche de marketing social. L’analyse préconise plutôt la mise en œuvre de toute une série de politiques générales et mesures pratiques de préventions:
1. Nous recommandons la production et la diffusion de différentes sources d’information traitant de la réduction des risques dans la consommation de drogue.
2. Nous recommandons d’assurer l’accès aux hommes gays à des services de consultation ‘gay-friendly’ axés sur la drogue et le sexe. Ces services doivent avoir des compétences dans la gestion des aspects psychologiques de la santé et des dommages résultant du chemsex.
3. Nous recommandons de travailler en collaboration avec les gérants de sexclubs sur l’élaboration de directives et guides de conduite clairs permettant de limiter les dommages.
4. Nous recommandons une coopération structurée (aux plans local, national et international) avec les entreprises et les médias gays (notamment ceux qui mettent à disposition des apps et sites de réseautage), pour débattre, dans le cadre de la responsabilité des entreprises vis-à-vis des utilisateurs de leurs services, des possibilités de mise en place d’une promotion de la santé et d’une réduction des risques.
Offres
Il existe à Londres une offre de conseil et soutien médical extrêmement complète et à bas seuil d’accessibilité. Le Chelsea and Westminster Hospital propose au 56 de la Dean Street dans le quartier de Soho, pour le compte du NHS Foundation Trust, un service médical et psychosocial sous le nom de Dean Street Express (Lien: http://www.chelwest.nhs.uk/services/hiv-sexual-health/clinics/dean-street-express):
«Dean Street Express est conçu pour les personnes ne présentant pas de symptômes qui souhaitent faire un check-up spécifique sur les maladies sexuellement transmissibles. Le service — basé à Soho — utilise les technologies de pointe pour vous fournir des résultats rapides. Ce service n’est disponible que sur rendez-vous. Dean Street Express est adapté à votre cas si vous ne présentez pas de symptômes (que vous n’avez rien remarqué d’inhabituel), que vous n’avez pas besoin de traitement ou que vous souhaitez simplement effectuer un check-up de routine concernant votre santé sexuelle.»
Sont également disponibles plusieurs vidéos explicatives (Lien http://dean.st/films/ ) sur le thème du chemsex.
A Zurich existe la possibilité de faire tester les drogues au Centre d’information sur les drogues (Drogeninformationszentrum - DIZ) (Lien http://saferparty.ch/diz.html). Il est également possible de recourir à l’offre de conseil gay-friendly d’ARUD (http://www.arud.ch/). Le DIZ publie régulièrement sur son site, dans le cadre de son programme complet de réduction des dommages (Harm Reduction Programme) une liste actualisée des drogues psychoactives proposées sur la scène du chemsex (Lien http://saferparty.ch/warnungen.html). Celle-ci contient une illustration de chaque pilule (avec données de couleur, forme et taille) et fournit des indications de composition et de dosage des substances concernées. L’attention est particulièrement attirée sur les effets secondaires liés au surdosage. Cette liste contient notamment les pilules constituant un risque élevé et qui ne doivent par conséquent pas être consommées. Elle vise à alerter dans le cas où ces pilules sont proposées lors d’une soirée.
Hansruedi Voelkle / octobre 2016
1 Voir: http://sigmaresearch.org.uk/files/report2014b.pdf
Une traduction allemande de l’association allemande d’Aide contre le Sida est disponible sous: http://www.hivreport.de/sites/default/files/ausgaben/2014_03_HIV%20report.pdf
2 La méphédrone est une pratique «anglaise» et n’est quasiment pas utilisée hors d‘Angleterre
3 Les poppers sont composés de nitrites d’amyle, nitrites d’isopropyle, nitrites de cyclohexile ou de mélanges de ces substances. Ils ont un puissant effet vasodilatateur (dilatation des vaisseaux sanguins)
Voir: https://de.wikipedia.org/wiki/Poppers
4 Sex and hepatitis C, a guide for healthcare providers.
http://www.chelwest.nhs.uk/services/hiv-sexual-health/professionals/links/ChemSex-Hep-C-Guide.pdf
5 Association allemande d’Aide contre le Sida: HIVreport.de: La consommation de drogue chez les MSM en Allemagne
6 Voir: http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/News/2014/0527/mm_drogen-abwasser_d.pdf
7 http://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/7667119--la-crystal-meth-est-une-bombe-a-retardement-selon-olivier-gueniat.html
8. Tagesanzeiger du 28.5.2014.
9. Quelques conclusions de la traduction allemande de l‘étude Chemsex.
- Détails
- Catégorie : Thérapie
En Australie (Commonwealth d’Australie comptant près de 24 millions d’habitants), quelque 230’000 personnes étaient infectés par le virus de l’hépatite C1 en 2012; ce chiffre croît d’environ 10’000 personnes par an. Parmi les personnes touchées, 58’000 souffrent de lésions hépatiques modérées à sévères. La tranche d’âge la plus représentée est celle des 51-60 ans. On estimait en 2012 que 75 % parmi ces 230'000 personnes avaient été diagnostiquées comme porteuses du VHC, 20 % étant en traitement et 11 % déjà guéries. Il y aurait selon l’OMS, à l’échelle mondiale, 150 millions de personnes infectées au VHC, avec une hausse annuelle de 3 à 4 millions.
En Australie, suite à l’augmentation, depuis quelques années, du nombre de décès dus à des maladies hépatiques induites par l’hépatite, le gouvernement a vu la nécessité d’agir, notamment auprès de ceux qui s’injectent des drogues (PWID) et qui forment la majorité des patients infectés au VHC. Le VHC a également été qualifié par le gouvernement de menace à la santé publique - on parle de pandémie silencieuse -, ce qui légitime un programme VHC national. Le gouvernement central australien a donc décidé, le 20 décembre 2015, de mettre en place une stratégie VHC globale: The Fourth National Hepatitis C Strategy 2014-2017.
Il existe depuis peu de nouvelles possibilités de traitement du VHC, qui agissent comme agents antiviraux directs, abrévié AAD, au lieu de l’interféron et de la ribavirine usuellement administrés. Les chances de guérison sont, à plus de 95%, très bonnes, la tolérance est sensiblement meilleure que celle de l’interféron et de la ribavirine, et on ne constate quasiment aucun effet secondaire.
Le programme VHC national pour le Commonwealth d’Australie vise à réduire les nouvelles infections de 50 % et à augmenter significativement le nombre de personnes traitées. Toutes les personnes concernées, sans restriction aucune, soit indépendamment de la manière et du lieu où elles ont été infectées, doivent avoir accès au traitement. Cela concerne également les patients présentant une réinfection ou en échec thérapeutique (Treatment Failure). Font aussi partie du programme la promotion du test de dépistage du VHC et une plus large information de la population; un programme de Réduction des Risques pour les PWID; la formation, l’information et la sensibilisation des médecins (tous les médecins sans exception peuvent prescrire les nouveaux médicaments anti-VHC), de même qu’un programme de surveillance collectant les données de traitement et de résultats (notamment l’adhérence) du programme à des fins d’évaluation statistique. On espère ainsi créer une situation ‘gagnant-gagnant-gagnant’, qui permettrait une amélioration notable à la fois pour les autorités, pour l’industrie pharmaceutique et avant tout, pour les personnes concernées. On est en outre convaincu qu’un traitement efficace s’accompagne d’un effet de prévention positif auprès de nombreuses personnes touchées par le VHC (comme pour le VIH). Les prévisions laissent espérer que si 80% des PWID infectés par le VHC sont traités avec succès, la prévalence du VHC devrait tomber, dans cette population, de 50% à 5%.
Le fait que ce programme ait pu voir le jour et le rôle de pionnier que joue ici l’Australie au niveau mondial s’explique largement par le type de négociations menées par le gouvernement avec les fabricants de médicaments. Avec près de 1% de personnes infectées par le VHC, l’Australie ne fait pas partie (comme par exemple la Suisse et le Portugal) des pays à forte prévalence, tels que peuvent l’être l’Egypte (22%, soit quelque 12 millions de personnes infectées par le VHC), le Pakistan (4.8%), ou la Chine (3.2%). Les négociations du gouvernement australien avec l’industrie pharmaceutiques peuvent être simplement résumées comme suit:
L’Australie est prête à accorder, pour un programme VHC national sur les cinq années à venir, 1 Mrd de Dollars australiens ( 0.70 €). Si l’Australie prend en charge les médicaments au «prix public des pays riches» d’environ 100’000.— AUD par traitement, seul un très petit nombre, à savoir quelques centaines de patients, pourra être traité et soigné, ce qui n’est ni juste ni cohérent avec une stratégie de santé publique. Au départ en effet, un traitement anti-VHC de 12 semaines aux USA coûtait 84’000.— Dollars US, soit plus de 1000.— US$ par comprimé. Il a été accordé par les fabricants un prix de 2000.— US$ par traitement pour les pays en voie de développement. Une étude de l’université de Liverpool estime, pour le sofosbuvir (nom de marque Sovaldi) de Gilead, un coût de fabrication actuel réaliste à 1.70 US$ par comprimé, soit près de 101.— US$ pour un traitement complet de 12 semaines, et ce du fait que les coûts de développement du médicament ont été déjà largement amortis par les gains réalisés à ce jour par l’entreprise.
En s’accordant, entre gouvernement et fabricant, sur un prix sensiblement plus bas, toutes les personnes touchées par le VHC en Australie pourraient sans doute être traitées dans les cinq ans à venir et très probablement guéries. Les fabricants ont certes ainsi un gain moindre par traitement, mais ils vendent en revanche un nombre de traitements nettement plus élevé (il s’agirait en Australie de plus de 200’000 traitements sur les cinq ans du programme) et les deux parties seraient ainsi gagnantes. Cette stratégie a apparemment convaincu les fabricants et un accord a été trouvé. La ministre de la santé australienne parle d’un prix par comprimé de 27.70 AUD, voire peut-être seulement 6.10 AUD (pour des coûts de fabrication d’environ 1 € par comprimé pour un traitement qui dure généralement 12 semaines) au lieu de 100’000.—AUD par traitement.
Des négociations similaires ont même eu pour résultat de permettre à l’Inde de fabriquer elle-même un générique, ramenant le prix d’un traitement entre 100.— et 300.— US$, tandis qu’une fabrication locale en Egypte autorise un traitement pour quelque 300.— US$. Cet énorme écart de prix a conduit les patients d’Europe (avec bien sûr une prescription valide de leur médecin traitant) à importer eux-mêmes les médicaments – de manière tout à fait légale – depuis l’Inde, mais à leurs frais à ce jour. Il est légitime de se demander si les coûts de ces médicaments à bas coûts importés directement doivent être pris en charge par nos caisses maladies. Si l’on peut avoir l’assurance que le médicament importé répond aux exigences de qualité et que le traitement s’effectue sous le contrôle du médecin traitant, rien ne devrait s’y opposer.
Selon un communiqué de presse australien de fin juillet 2016, 22’470 personnes ont déjà bénéficié du nouveau traitement anti-VHC depuis le début du programme; quand elles n’étaient que 2’000 à 3'000 par an auparavant. On a bon espoir d’atteindre les objectifs du programme: réduire de 90% le nombre de nouvelles infections par le VHC et l’hépatite B, faire reculer de 65% le nombre de décès liés au VHC et à l’hépatite B, vacciner 90% des enfants contre l’hépatite B, faire bénéficier d’un traitement 90% des personnes diagnostiquées en 2030 et avoir guéri, en 2030 toujours, 80% des personnes atteintes du VHC et de l’hépatite B.
Il faut espérer que d’autres pays mettent en place des programmes nationaux du même type, développent et mettent en œuvre une collaboration avec l’industrie pharmaceutique qui aille dans le sens des intérêts des personnes concernées. C’est ainsi que le Portugal a décidé en février 2015 d’un programme VHC national qui devrait permettre aux 13’000 personnes concernées par le VHC au Portugal d’avoir accès à un traitement dans les trois années à venir. S’il a été décidé de taire le prix négocié pour les médicaments, les déclarations du ministre de la santé portugais laissent entendre que les prix auraient diminué de moitié depuis le début des négociations. À février 2016, 7000 personnes avaient déjà reçu un traitement, avec un taux de succès de 96%. D’autres pays européens (par ex. l’Ecosse, la France et la Slovénie) ont également initié un programme VHC national.
John F. Dillon (Professeur d’Hépatologie et Gastro-entérologie, Université de Dundee) explique: «Si le Portugal peut le faire, aucun autre pays industrialisé n’a d’excuse pour ne pas faire de même. Ils n’avaient pas la puissance économique d’autres pays, donc si le Portugal décide de s’engager dans cette voie, cela veut dire que les autres pays en sont capables.»
Il vaudrait la peine d’évaluer si plusieurs pays en Europe ou dans l’UE n’auraient pas intérêt à développer une stratégie VHC commune et à négocier ensemble des conditions de prix et de mise en œuvre avec l’industrie pharmaceutique. Il est à prévoir que d’autres médicaments extrêmement chers soient développés à l’avenir, nécessitant également, dans l’intérêt de la santé publique, une intervention modératrice des autorités nationales de santé en matière de prix, si l’on veut les rendre accessibles aux patients concernés. Le traitement anti-VHC pourrait en ce cas servir de précédent.
Pour finir, un extrait des recommandations de l’OMS (Hépatite C, Aide-mémoire, mise à jour juillet 2016):
«Tous les adultes et tous les enfants atteints d’une infection chronique par le virus de l’hépatite C doivent faire l’objet d’une évaluation en vue du traitement antiviral. … L’OMS recommande que tous les patients atteints d’une hépatite C soient traités avec des schémas thérapeutiques comprenant des AAD, à l’exception de quelques groupes spécifiques pour lesquels les schémas à base d’interféron pourront encore être employés (en tant que schémas alternatifs chez les patients infectés par un virus du génotype 5 ou 6 et ceux porteurs d’un virus du génotype 3 et d’une cirrhose).»
VIH Glasgow 2016: la question des coûts thérapeutique
Hansruedi Völkle / Novembre 2016
VHC = Virus de l’Hépatite C
- Détails
- Catégorie : Thérapie
Dans la dernière newsletter d’octobre, nous avons traité du risque d’infarctus en lien avec l’abacavir 1. Nous avons, dans nos commentaires, placé ce risque dans un contexte élargi, incluant notamment le tabagisme et la consommation de cocaïne.
Les 26 et 27 septembre s’est tenue à Washington D.C. la «7e conférence internationale VIH/vieillissement». Les chercheurs Althoff, Gange et Gebo ont présenté une étude de la cohorte nord-américaine NA-ACCORD, pour laquelle ont été analysées les données de 29'000 patients.
Leurs conclusions sont sans appel: le contrôle du tabagisme et de la pression artérielle réduit d’un tiers le risque d’infarctus de type 1, et d’un quart celui de type 2.
- Détails
- Catégorie : Thérapie
Le traitement combiné anti-VIH est un modèle de réussite, ce que l’on ne saurait assez souligner. Il est efficace, bien toléré, facile à prendre et accessible, en Europe de l’Ouest, à tous les patients à un coût raisonnable. L’espérance de vie des patients VIH est presque la même que celle des sujets sains. Ce traitement est de plus, pour tous, un instrument de prévention très efficace. À ce niveau de résultat très élevé, des améliorations sont-elles encore possibles?
Roy Gulick du Weill Cornell Medical College de New York s’est posé la question: le niveau de réussite est très élevé, et le mieux est l’ennemi du bien. S’agit-il de 29 ou 30 médicaments autorisés, dans 5 ou 6 classes fonctionnelles? On cite les deux chiffres et tous deux sont justes. En Europe, seuls quelques patients ont encore besoin de l’inhibiteur de fusion T-20. Cette substance coûteuse était, il y a dix ans, d’une importance vitale pour nombre de patients présentant des résistances multiples, sa place est aujourd’hui marginale.
Gulick a comparé, dans sa présentation, les cinq directives thérapeutiques internationales majeures (US DHHS, IAS-USA, EACS, BHIVA et OMS 1). Celles-ci s’accordent comme jamais auparavant. Tous les individus atteints du VIH doivent être traités. L’OMS seule souhaiterait établir des priorités pour les personnes ayant un nombre de CD4 inférieur à 350. L’OMS veut toutefois traiter, dans la mesure du possible, l’ensemble des personnes concernées. Selon les directives, il y a au total dix traitements de première ligne recommandés. A savoir: deux inhibiteurs nucléosidiques (INTI) avec soit un inhibiteur non nucléosidique (INNTI), soit un inhibiteur de la protéase (IP) ou un inhibiteur de l’intégrase (INI).
Efficacité
En 1995, à peine 43% des patients VIH atteignaient l’objectif d’une charge virale indétectable. Dans les nouvelles études comme dans l’étude suisse de cohorte VIH, on est à plus de 90%. Les multirésistances sont devenues très rares en Suisse, comme nous l’avons déjà rapporté 2. Mais ce n’est pas partout le cas et les nouvelles substances doivent donc agir contre les résistances connues.
Pipeline
Sont actuellement en phase de développement de nouveaux inhibiteurs nucléosidiques et non nucléosidiques, de nouveaux inhibiteurs de l’intégrase et inhibiteurs d’entrée, dans les classes thérapeutiques déjà connues. Font partie des nouvelles classes ce que l’on nomme les inhibiteurs de fixation (actuellement en phase 3, dernière étape avant autorisation), de même que les inhibiteurs de maturation (actuellement en phase 2, phase de détermination de la dose).
Tolérance
Pour les patients sous thérapie à long-terme, la tolérance est l’une des questions majeures. Si, il y a 20 ans, 14% des participants aux études interrompaient un traitement, vital à l’époque, pour cause d’intolérance, ils ne sont plus que 1 à 3% dans les dernières études, et ces patients ont, contrairement au passé, des alternatives. L’éfavirenz bien connu agit aussi à dose plus faible et, est ainsi mieux toléré. En outre, une substance beaucoup plus faiblement dosée vient remplacer le ténofovir, problématique à long terme. Elle doit toutefois encore faire ses preuves dans la pratique quotidienne, en dehors des études.
Il est régulièrement tenté, pour le traitement d‘entretien, après un début réussi et une baisse efficace de la charge virale, de réduire le nombre de substances de trois à deux, voir à une seule substance. Il est probable que les bithérapies soient un jour intégrées aux directives comme traitement d’entretien, mais il est encore trop tôt. Si l’on continue d’étudier les monothérapies, celles-ci restent, de l’avis de l’auteur, fort peu réalistes.
Dosage facile
La fameuse poignée de comprimés à avaler deux fois par jour est heureusement de l’histoire ancienne. Pour la plupart des patients, il ne s’agit aujourd’hui que d’«un comprimé par jour», ou du moins, de «2 à 3 comprimés, une fois par jour». Et l’on espère de nouvelles améliorations dans un avenir proche, soit dans les trois à cinq ans. Nous parlons ici par exemple de formulations à effet retard, injectées toutes les 8 à 12 semaines ou administrées tous les deux mois par le biais de petits implants.
Accès au traitement
Alors qu’en 2010, 7,5 millions de personnes atteintes du VIH avaient accès à un traitement, on en comptait déjà 17 millions en 2015. Si les progrès sont énormes, nous ne touchons pour autant pas au but. La situation en Europe de l’Est et en Asie centrale (ex. Union soviétique) reste très problématique et confuse. Jusqu’à 90% des patients sont co-infectés à l‘hépatite C, beaucoup présentent en outre des tuberculoses multirésistantes, à quoi s’ajoute une forte stigmatisation – un cercle vicieux avec peu de perspectives d’amélioration à court terme.
Espérance de vie
Dans l’étude suisse de cohorte VIH, l’espérance de vie des sujets atteints du VIH a énormément augmentée. Les personnes d’un bon niveau d’éducation vivant avec le VIH ont aujourd’hui une espérance de vie identique à celle de la population saine. D’autres améliorations sont à attendre.
Conclusions
- Efficacité: elle reste aussi bonne et s’améliore surtout en cas de multirésistances
- Sécurité, tolérance: autres améliorations à venir
- Commodité: autres améliorations à venir
- Efficience économique: autres améliorations à venir
- Accès au traitement: on s’attend à d‘importantes améliorations (objectif OMS: 20 millions de personnes sous traitement d’ici 2020)
- Espérance de vie: autres améliorations à venir, avec un chiffre qui pourrait même dépasser celui de la population saine. La raison principale est la qualité du suivi des patients.
David Haerry / Novembre 2016
1 US DHHS 2016: www.aidsinfo.nih.gov; IAS USA 2016: JAMA 2016;316:191; EACS 2016, www.eacsociety.org; UK 2016, wwwbhiva.org; WHO 2016: who.int/hiv/pub/guidelines/en/
2 http://neu.positivrat.ch/medizin/therapie/167-neues-aus-der-kohortenstudie-shcs-neues-aus-der-kohortenstudie-shcs-therapieresistenzen-sind-geschichte-1.html
Page 2 sur 8