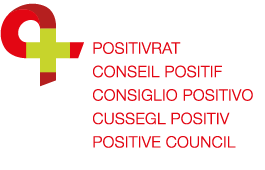Actuel
- Détails
- Catégorie : Thérapie
Les discussions sur la PrEP ont été l’un des thèmes majeurs de la conférence de Glasgow, fin octobre 2016. D’une part parce que la thématique est discutée dans beaucoup de pays européens, d’autre part parce qu’en Angleterre, l’accès à la PrEP et la prise en charge des coûts restent toujours sans solution. La Norvège a créé la surprise: le ministère de la santé annonçait le 20 octobre que l’accès à la PrEP serait désormais gratuit à travers le système national de santé publique.
La Norvège est ainsi, après la France, le deuxième pays en Europe donnant accès à la PrEP, et le premier pays au monde à proposer gratuitement le comprimé préventif. Ce n’est qu’après la conférence qu’on a appris que le NHS, en Angleterre, a été débouté en appel. Les juges ont estimé que le NHS était responsable de la délivrance du PrEP. Le jugement a notamment été justifié par le fait que la prophylaxie pré-exposition est déjà prise en charge.
Les ajournements concernant la prise en charge en Angleterre ont poussé les activistes engagés pour la PrEP à créer un site de vente en ligne (iwantprepnow.co.uk). Ce site Web liste 4 sources de Truvada générique. Le coûts mensuel va de 31£ à 78£ pour une boîte d’un mois 1. La Dean Street Clinic à Soho, à Londres, est le point de contact des hommes gays porteurs de maladies sexuellement transmissibles. Le nombre croissant de patient se procurant une PrEP en ligne a incité la clinique à faire une étude 2. Le taux plasmatique de médicament concernant le Truvada a été étudié dans une population de 234 clients de la pharmacie en ligne entre février et septembre 2016. Il se pourrait tout à fait que le caractère inofficiel de cette source d’achat du médicament induise une négligence ou une moindre exactitude dans la prise.
Les hommes étaient âgés de 37 ans en moyenne. Un tiers d’entre eux étaient actifs sur la scène Chemsex. 85% prenaient quotidiennement la PrEP, 15% seulement en fonction du besoin. Presque deux-tiers de ces acheteurs directs utilisent le canal www.unitedpharmacies-uk.md; et la quasi-totalité achète le générique Tenvir-EM du laboratoire indien Cipla.
Les chercheurs ont comparé les niveaux sanguins des acheteurs directs avec ceux des patients se procurant le Truvada en clinique – soit comme participants à l’étude PROUD, soit comme participant payant. Les taux de médicament étaient comparables chez tous les participants, et suffisamment élevés pour prévenir une infection au VIH. Aucun patient n’a d’ailleurs contracté l’infection au VIH sur la courte durée d‘observation. Cette petite étude a permis de répondre aux questions les plus importantes:
- Personne n’a pris de médicament falsifié ou d’efficacité insuffisante
- Tous présentaient des taux de médicament suffisamment élevés pour prévenir une infection.
Nneka Nwokolo a présenté les données. Elle a conclu en disant que «tant que la PrEP n’est pas disponible via le NHS, il est important de fournir à tous les utilisateurs potentiels un accès à la PrEP accessible en termes de prix». Nous nous rallions volontiers à son avis.
Ni l’autorisation officielle par Swissmedic, ni la prise en charge par l’assurance de base n’étant à l’ordre du jour en Suisse, le site iwantprepnow.co.uk est donc intéressant pour les utilisateurs suisses également. Pour éviter les problèmes d’importation, l’acheteur doit présenter une ordonnance médicale et ne faire venir au maximum que trois mois de doses à la fois.
Concernant l’autorisation par Swissmedic, Gilead, laboratoire détenteur du brevet, s’est depuis exprimée. Les procédures Swissmedic sont apparemment trop compliquées et fastidieuses pour l’entreprise. Il y a du vrai: l’extension d’une autorisation existante requiert, en Suisse, de refaire une nouvelle demande – ce qui nécessite plus d’une année. Il existe en Europe, pour ce type de cas, des procédures spécifiques allant de 60 à 90 jours. Nous sommes malgré tout d’avis que l’entreprise devrait s’engager plus. Il ne faudra pas s’étonner si les génériques prennent, là encore, la main sur notre marché. Un engagement de l’entreprise Gilead pour une étude de mise en œuvre de la PrEP en Suisse serait également plus que bienvenue. Elle est nécessaire, car la prescription à large échelle de la PrEP implique certains défis au niveau du système de santé publique. Nous connaissons des cliniques qui seraient très intéressées par une telle étude.
David Haerry / Novembre 2016
1 Prix public pour la préparation originale en Suisse Fr. 899.30 (Source: Compendium CH, vérifié le 27.11.2016) Wang X, Nwokolo N (presenter), Boffito M et al. 2 InterPrEP: internet-based pre-exposure prophylaxis (PrEP) with generic tenofovir DF/emtricitabine (TDF/FTC) in London – analysis of pharmacokinetics, safety and outcomes. International Congress on Drug Therapy in HIV Infection (HIV Glasgow), Glasgow, abstract O315, 2016.
- Détails
- Catégorie : Thérapie
Les coûts thérapeutiques ne sont généralement pas un thème abordé en congrès scientifique. La raison en est simple: le corps médical s’occupe d’un diagnostic correct et d’un traitement approprié. Le prix fait quant à lui l’objet de négociations entre les autorités de santé publique et l’industrie, de manière le plus souvent ultra confidentielle. Les grandes difficultés, partout en Europe, liées à la prise en charge des coûts des nouveaux traitements contre l’hépatite C ont permis de sensibiliser les médecins et les autorités de régulation des différents pays. Andrew Hill, du Chelsea Westminster Hospital à Londres, a fait sur le sujet une passionnante conférence à l’ouverture du congrès.
Le titre «Traitements du cancer, du VIH et de l’hépatite virale en Europe via les génériques: que peut-on faire?» est clair: Andrew Hill voit grand. Il ne demande pas moins qu’un objectif 90-90-90 pour le traitement global de l’hépatite virale, du VIH et de la tuberculose, ce qu’il justifie par l’énorme baisse des coûts de production. Son engagement s’explique par le refus du NHS 1, en Angleterre, de prendre en charge des coûts de 4800£ pour une PrEP, et resp. de 30'000 à 100’000£ pour la guérison d’une hépatite C.
On pensait encore impossible en 1999, pour des raisons de coût, la mise en œuvre d’un traitement anti-VIH en Afrique. Mais un an plus tard, Yussef Hamied, du laboratoire de génériques indien Cipla, s’exprimait sans détour lors d’un sommet du G8: «Mon entreprise de médicaments génériques peut produire des médicaments antirétroviraux pour un dollar par jour». Le monde s’étonnait, alors que la Thaïlande avait fait la même chose trois ans auparavant. Mais seul le géant indien des médicaments génériques rendait le produit intéressant pour l’Afrique, en fournissant aussi les marchés d’exportation.
Andrew Hill a montré l’ampleur de la baisse des coûts de production des médicaments générée par les économies d’échelle 2. Un traitement antituberculeux générique à destination des pays à faible revenu ne coûte plus aujourd’hui que 90$ pour 6 mois.
Les prix fortement réduits des matières premières pour les médicaments contre l’hépatite C abaissent les coûts de production d’un traitement de 12 semaines nettement en dessous de 100$ pour le sofosbuvir et le daclatasvir, et aux alentours de 100$ pour l’association sofosbuvir/lédipasvir. Le prix de la substance active du sofosbuvir est tombé, entre janvier 2015 et août 2016, de 9000$ le kg à 1100$. Il en découle un prix «ex factory» théorique de 62$ pour 12 semaines de sofosbuvir générique. En Allemagne, le prix de 12 semaines de sofosbuvir est actuellement de 50’426€ 3, et en Suisse, de 46'914 francs 4.
Un rapide commentaire s’impose ici. Les réductions massives des coûts de production sont dues pour une large part à ce que l’on nomme les programmes «d’accès» pour les pays défavorisés et à l’attribution volontaire de licences pour des marchés spécifiques. Un exemple parmi beaucoup d’autres: en Egypte, fortement touchée par l‘hépatite C, le gouvernement paye 900$ par traitement. Des programmes similaires sont à l’origine du large accès aux traitements anti-VIH en Afrique. Ces programmes sont durables, car les pays qualifiés de riches étaient prêts à continuer à acquitter des prix élevés.
Attardons-nous encore un peu sur l‘hépatite C. Certains «pays riches» se sont en l’occurrence courageusement battu et ont bien négocié. En Espagne, 12 semaines de sofosbuvir coûtent 13’000€, en Australie 3500€ seulement. Ce ne sont pas là pourtant des pays pauvres bénéficiant de programmes «d’accès» - comment est-ce possible? Rien de plus banal en fait: l’industrie pharmaceutique veut vendre ses médicaments. Ceux qui s’engagent sur certaines quantités se voient accorder les meilleurs prix. L’Australie a imaginé une stratégie anti-hépatite et s'est fixé comme objectif d’éradiquer l’hépatite C d’ici 2026. Le gouvernement a apporté son soutien sans réserve au programme. Plus de 120'000 patients devraient être guéris dans les cinq ans à venir, 40'000 en 2016 selon les prévisions. Cela représente un budget de traitement annuel de 200 millions d’AU$. Alors qu’une véritable vision est nécessaire, on doit s’accommoder, en Suisse, de multiples limitations. On peut, on doit en tirer les leçons.
On retrouve pour l’entécavir une situation similaire à celle de l’hépatite C. Le brevet protégeant ce médicament utilisé pour le traitement de l’hépatite B arrive à expiration en 2017. Le prix officiel de l’entécavir se monte aux USA à 15’111$ par année et par patient. On est en France et en Angleterre aux environs de 7000$, et ce pour des coûts de production estimés de 36$ - du point de vue purement théorique, un prix de 90$ par année et par patient devrait être possible.
Et pour le VIH?
Beaucoup des médicaments les plus prescrits actuellement vont perdre la protection que leur confère leur brevet dans les quelques années à venir. Il serait donc théoriquement possible de réaliser des économies de coût. Il existe déjà des génériques pour l’éfavirenz et la lamivudine, abacavir/lamivudine et lopinavir/ritonavir suivent fin 2016. D’autres substances encore suivront en 2017 et 2018. Si ce n’est qu’en Suisse, aucun patient quasiment ne prend plus d’éfavirenz, et ce pour de bonnes raisons, de même concernant l’association lopinavir/ritonavir. Tant que sortiront de meilleures substances, et surtout des substances mieux tolérées, les éventuels avantages de coût des génériques sont voués à rester purement théoriques.
A quel degré la transparence est-elle envisageable?
L’intervention d’Andrew Hill a été instructive et a alimenté toutes les discussions à Glasgow. Les choses ne sont toutefois pas aussi simples qu’il les a présentées. Nous évoluons dans un environnement extrêmement réglementé, qui ignore le concept même de transparence vis-à-vis de l’extérieur. Ce sont ces milieux ultra réglementés qui décident du prix des médicaments, et non les coûts de production. Les fabricants de génériques sont eux aussi des commerçants. Ils n’investissent pas en recherche, ne prennent quasiment aucun risque, mais maximisent toutefois les prix.
L’industrie pharmaceutique impliquée dans la recherche soigne et défend avec beaucoup d’énergie son image de novatrice. Elle est dans de nombreux pays, en Suisse notamment, un contribuable important et un employeur recherché. On fait en général l’impasse sur sa production à petite échelle, le peu de concurrence réelle à laquelle elle est soumise et la faible compétitivité qui est en réalité la sienne. Au lieu des grandes chaînes de production de l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique travaille sur le mode de la confection, un peu comme une confiserie de qualité dans un grand centre urbain. Dans les petits pays, les patients veulent eux aussi être approvisionnés en produits autorisés là-bas. Les problèmes de disponibilité ne sont pas tolérés. Le système requiert, à tous les niveaux, énormément de personnel.
Et maintenant?
Les systèmes de santé, même ceux des pays riches, ont une pression énorme en termes de coûts. S’ils veulent fonctionner à long terme, ces systèmes doivent impérativement se consolider. De bons médicaments coûteux ne servent à personne si leur prix est prohibitif et que les patients ne peuvent se les procurer. Maintenir le bon fonctionnement de systèmes aussi complexes demande énormément de travail et d’effort, encore plus de bonne volonté et avant tout, une plus grande transparente de part et d’autre. Le corps médical et les patients comprennent bien que tout n’est pas finançable. Ils aimeraient toutefois être pris au sérieux et respectés, en tant qu’acteurs capables de réfléchir par eux-mêmes. Le modèle australien pour l’hépatite C doit, en Suisse également, avoir vocation d’exemple.
David Haerry / Novembre 2016
1 National Health Service, le système de santé publique anglais
2 Economies d’échelle: Lien entre quantité produite et volume de facteurs de production utilisés. Les économies d’échelle rendent possible la production de masse.
3 Il s’agit du prix le plus élevé pour le sofosbuvir en dehors des USA. Il devrait être plus bas dans la pratique, car les caisses-maladie publiques en Allemagne se négocient des rabais et remises de prix. Ceux-ci ne sont pas publics.
4 Compendium.ch, vérifié le 28 novembre 2016
- Détails
- Catégorie : Études
La ‚Data Collection on Adverse Events‘ – ou collecte d’informations sur les incidents – dans l’étude sur les médicaments anti-VIH (D:A:D) est une collaboration entre 11 études de cohorte européennes, américaines et australiennes réunissant 49'000 patients séropositifs. L’étude suisse de cohorte VIH collabore depuis longtemps déjà à l’étude D:A:D. L’étude D:A:D présentait pour la première fois en mars 2008 des données indiquant que l’utilisation d’Abacavir générait une augmentation du risque d’infarctus du myocarde de près de 90% - une découverte qui effrayait de nombreux patients. Les autorités américaines, la FDA, adaptait les informations patients contrairement aux autorités européennes, l’EMA, qui elle, se refusait à le faire – les données ne semblant pas suffisamment fondées.
Après les surprenants résultats obtenus par D:A:D en 2008, plusieurs autres études ont tenté de reproduire ces mêmes résultats – avec des bilans différents. Certaines études arrivent aux mêmes résultats, d’autres pas. Certaines études mettent par exemple à jour la disparition de l’association infarctus du myocarde/Abacavir si l’on adapte les analyses en fonction des troubles de la fonction rénale et de la consommation de drogue. De même les méta-analyses produisent des données diverses. D’autres études tentent de comprendre les mécanismes expliquant le lien supposé.
Les études de cohorte sont des études de suivi, avec pour inconvénient que divers facteurs d’influence peuvent impacter les résultats. Quand ces facteurs sont connus, ils peuvent être évalués et pris en compte, dans le cas contraire, la situation se complique. Dans l’idéal, une étude randomisée doit alors faire la preuve de l’effet, ou il doit être confirmé par une seconde étude de cohorte.
En 2008 était soulevé le fait que le médicament était donné prioritairement à des patients présentant un risque préalable élevé d’infarctus du myocarde, ce qui pouvait expliquer l’effet observé. L’Abacavir était en effet auparavant prescrit en lieu et place d’autres substances plus anciennes influençant le taux des lipides sanguins. Il a été, sur cette base, présumé que les patients à qui était prescrit l’Abacavir avaient d’emblée un risque d’infarctus du myocarde plus élevé. D’autres facteurs d’influence possibles avait été pris en compte dans d’anciennes analyses: âge des patients, voies de transmission du VIH, origine ethnique, année calendaire, cohorte, tabagisme, risques familiaux et personnels, indice de masse corporelle, de même que d’autres médicaments anti-VIH. Des analyses ultérieures avaient également retenu les troubles de la fonction rénale comme facteur d’influence.
L’étude D:A:D a en outre montré que le risque disparaissait clairement une fois l’Abacavir arrêté et qu’il n’avait pu être démontré aucun lien entre prise de Ténofovir et risque cardiovasculaire. Les directives de traitement mentionnent depuis 2008 un possible risque, qui se traduit par une modification des pratiques de prescription. La nouvelle étude récemment publiée tient compte de la compréhension maintenant meilleure des possibles liens de cause à effet.
Les données ont été collectées lors de contrôles de routine. Elles comprennent les facteurs sociodémographiques, les maladies et cas de décès liés au sida, les risques cardiovasculaires, les résultats d’analyse tels que CD4 et charge virale, les maladies cardiovasculaires, les informations relatives au traitement et les médicaments influençant le risque cardiovasculaire. Il a été défini trois groupes – le premier de 1999 à 2000, le second à partir de 2004 et le troisième à partir de 2009.
Expliquer le procédé statistique complexe s’avère difficile dans cette présentation succincte. L’essentiel en bref: les données de tous les patients observés ont été évaluées une fois par an et le risque cardiovasculaire sur les 10 années suivantes a été analysé selon l’échelle de Framingham. Les patients analysés ont été répartis en différentes catégories de risque et classés en fonction d’un risque d’infarctus du myocarde préexistant faible (sous 10%), moyen (10-20%) ou élevé (plus de 20%) ou d’un risque inconnu. Il a également été analysé une éventuelle évolution du lien observé en 2008 entre utilisation d’Abacavir et infarctus du myocarde depuis les premières études. Entre autres éléments intéressants, la diminution de la proportion de fumeurs depuis 2005, l’amélioration des taux de lipides sanguins, l’augmentation des valeurs de CD4 résultant de meilleurs traitements et une charge virale généralement moindre. Le recours à l’Abacavir a doublé entre 2000 et 2008, passant de quelque 10% à presque 20%. Il recule un peu après 2008, retombant à 18%. Dans le groupe des patients présentant un risque cardiovasculaire moyen, le recours à l’Abacavir a augmenté pour passer de 15% en 2000 à plus de 25% en 2008, avant de s’établir à 21% en 2012. Dans le groupe à haut risque, les valeurs étaient respectivement de 17,5%, 26,6% et 21,7%. Après 2008, il a été moins souvent prescrit aux patients à risque cardiovasculaire moyen et élevé un premier traitement contenant de l’Abacavir. Depuis 2008 dans ces mêmes groupes, l’Abacavir a aussi été plus fréquemment qu’auparavant remplacé par d’autres substances.
Selon l’étude D:A:D, le lien entre Abacavir et risque cardiovasculaire élevé reste identique. Les patients sous Abacavir présentaient un risque d’infarctus deux fois plus élevé que les patients à qui n’avait pas été prescrit d’Abacavir. On ne saurait toutefois exclure des facteurs d’influence inconnus. Compte tenu du fait que l’Abacavir est un composant de plus en plus fréquent des médicaments composés, nous devons à l’avenir tabler sur une utilisation croissante du produit.
Depuis 2008, certains groupes de recherche tentent de reproduire les résultats de l’étude D:A:D – cela ne réussit pas toujours et le résultat a surtout été mesuré dans des études de suivi. Plusieurs méta-analyses d’études randomisées n’ont pu prouver l’effet. Il se peut toutefois que les patients inclus dans ces études présentent un meilleur état de santé général et un plus faible risque cardiovasculaire. L’une des raisons de la poursuite de ce débat réside dans le fait qu’il n’a pu être identifié aucun mécanisme biologique.
Conclusions
Les auteurs de l’étude D:A:D continuent de voir un lien très fort entre l’utilisation faite aujourd’hui de l’Abacavir et l’infarctus du myocarde. Malgré ces nouvelles données, une étude randomisée d’envergure suffisante pour aller au fond de la question ne serait pas défendable d’un point de vue éthique. En conclusion: il n’a toujours pas pu être établi de lien parfaitement évident. Les auteurs recommandent toutefois que le risque éventuel soit discuté avec le patient, de façon ce que la décision prise le soit en toute connaissance de cause.
Commentaire
La dernière phrase concernant la discussion avec le patient nous semble d’une importance capitale. Si cette discussion doit avoir lieu, elle d’ailleurs doit également évoquer beaucoup d’autres facteurs. Existe-t-il des risques cardiovasculaires dont le médecin n’a pas connaissance et dont le patient n’aurait pas conscience? Un élément clé: la consommation de tabac (combien? – dans la plupart des cohortes, l’information se limite à oui ou non, sans aucune donnée de volume). Beaucoup de cohortes comptent jusqu’à 60% de patients classés comme fumeurs avérés. Autre élément clé: la consommation de cocaïne – un sujet en Suisse, surtout. Tous les patients l’admettent-ils?
Les risques que présentent les autres médicaments doivent également être pris en compte, discutés et observés. Il n’existe pas aujourd’hui et il n’existera pas demain de traitement anti-VIH efficace et sans risque. Il est possible d’observer, d’évaluer, de discuter, et dans de nombreux cas, de faire le choix du traitement optimal. Quant au message le plus important concernant le risque cardiovasculaire à faire passer aux patients, il est de ne pas fumer, de ne pas consommer de cocaïne, d’avoir une alimentation équilibrée (régime méditerranéen) et de faire régulièrement de l’exercice – cela permet d’économiser de l’argent et de rester en bonne santé.
David Haerry / octobre 2016
1 C. Sabin et al, “Is there continued evidence for an association between abacavir usage and myocardial infarction risk in individuals with HIV? A cohort collaboration”, BMC Medicine (2016) 14:61 DOI 10.1186/s12916-016-0588-4
- Détails
- Catégorie : Thérapie
Des données sensationnelles dans le domaine de la prévention ont fait les gros titres cette année lors du congrès de l’IAS à Rome. L’efficacité de la thérapie comme instrument de prévention a été prouvée très clairement. Les bons résultats obtenus avec les microbicides, la PrEP, les stratégies de « test and treat » et les progrès en matière de vaccins sont très encourageants. Il semble que l’épidémie ralentisse dans certains groupes de population et même qu’elle puisse être arrêtée dans d’autres. Reste à savoir comment s’y prendre en pratique.
Le 18 juillet, les résultats de l’essai HPTN-052 ont été présentés et salués devant toute la salle plénière. Ce grand essai a apporté une preuve irréfutable de l’efficacité de la thérapie dans la prévention.
Depuis 2005, le HPTN-052 a contrôlé au total 1763 couples hétérosexuels sérodiscordants au Malawi, au Zimbabwe, au Botswana, au Kenya, en Afrique du Sud, au Brésil, en Thaïlande, aux États-Unis et en Inde. Les critères d’inclusion étaient les suivants : le partenaire infecté (homme ou femme) n’est pas encore indiqué pour une thérapie en raison de taux de CD4 élevés ; le partenaire régulier est séronégatif. Les patients ont été répartis en deux groupes : l’un a été traité immédiatement par thérapie antirétrovirale en cas de taux de CD4 compris entre 350 et 550/ml, l’autre a attendu que la thérapie soit indiquée selon les directives nationales (taux inférieur à 250 CD4/ml). Le critère d’évaluation primaire de l’essai était l’infection du partenaire régulier avec le virus du partenaire infecté.
Un essai de longue durée pour des résultats sans équivoque
Sur une période d’observation de 2 ans en moyenne, 39 partenaires de l’essai ont été infectés. Chez 28 nouveaux infectés, on a pu prouver que l’infection venait du partenaire régulier ; chez 11 autres, cette possibilité a été exclue. Sur 28 infections au sein du couple, 27 se sont produites dans le groupe non soumis à thérapie. L’infection dans le groupe des patients sous thérapie est un cas intéressant. Cette infection nouvelle a toutefois été détectée dès le premier contrôle à 90 jours. L’analyse des tests porte à croire que l’infection n’était pas tout à fait récente. Sur la base de l’évolution des virus VIH, les auteurs ont calculé que la date probable d’infection remontait à -85 jours, soit précisément au début de la thérapie VIH. Cela signifie que personne n’a été contaminé pendant la thérapie établie. Ainsi, la thérapie VIH réduit à elle seule de 96% le risque de transmission au sein du couple. Ces données ont été annoncées début mai, lorsque l’essai a été arrêté prématurément en raison des données univoques. Ceci confirme clairement les hypothèses sur lesquelles se basait la déclaration 2008 de la CFPS.
Un timide espoir pour les pays du Sud
Les résultats du HPTN-052 vont bouleverser le débat sur les programmes de thérapie et leur début, en particulier dans les pays du Sud, qui sont aussi les plus touchés. Quelques voix se sont élevées pour mettre en garde contre un optimisme excessif : « les scientifiques et les militants auront encore besoin de beaucoup de force de persuasion pour convaincre les autorités et les pays donateurs de l’importance de ces données et de la nécessité urgente d’adapter les programmes de traitement dans les pays les plus gravement touchés par le VIH », déclare le Dr Eli Katabira, président de l’International AIDS Society. « Ne sous-estimez pas la puissance d’un argument scientifiquement fondé, au lieu de gesticuler », réplique Anthony Fauci du National Institute of Health, aux États-Unis.
Une autre séance s’est penchée sur les étapes à suivre pour mettre en œuvre le traitement comme programme de prévention. La principale difficulté sera de dépister toutes les personnes infectées par le VIH. Dans la plupart des pays, la majorité des personnes vivant avec le VIH/SIDA ne sait pas qu’elle est infectée. Des programmes de test les plus ciblés possible sont également nécessaires, avec début du traitement immédiat et suivi à long terme.
De nombreux participants du congrès ont soutenu qu’il n’était éthiquement pas défendable de surseoir au traitement pour les personnes infectées par le VIH vivant en couple sérodiscordant. Mais cette question ne fait pas non plus consensus : dans certaines régions du monde, la majorité des personnes infectées par le VIH, qu’elles soient diagnostiquées ou non, ne vivent pas en couple sérodiscordant. Doit-on leur refuser la thérapie pour favoriser les autres ?
Les droits de l’homme offrent aussi matière à discussion. Les patients doivent pouvoir être associés à la décision de thérapie et nul ne doit être forcé à se soigner pour des raisons de politique sanitaire. L’OMS en particulier doit désormais être mise à contribution pour rédiger des directives sur le rôle de la thérapie dans la prévention.
Que signifient ces données pour l’Europe, pour la Suisse ?
Certains pays devront s’adapter aux directives sur la thérapie. Ceci doit se faire avec précaution, car tous les bénéfices d’une thérapie précoce pour les personnes infectées par le VIH ne sont pas encore clairement établis. L’essai START en cours en Suisse contribuera à apporter plus de lumière en ce domaine. En Suisse, la thérapie précoce dès le diagnostic est d’ores et déjà possible, et cette possibilité est déjà utilisée, sur recommandation du médecin ou sur demande du patient qui souhaite protéger son partenaire. Les changements devraient donc être mineurs en Suisse, si ce n’est que la tendance existante se renforcera.
La Suisse doit réfléchir d’une part à la stratégie de prévention, d’autre part aux recommandations de tests pour les hommes homosexuels au comportement à risque. La stratégie de prévention actuelle repose sur le principe que « chacun se protège soi-même ». Ceci n’est plus tout à fait pertinent, il est manifeste que nous pouvons faire quelque chose et proposer une aide utile à l’ensemble de la société. Les recommandations de tests doivent de toute urgence être adaptées au comportement à risque spécifique des hommes homosexuels et des MSM. Ceux qui ont beaucoup de relations sexuelles doivent se faire tester plus souvent, une fois par an ne suffit pas.
Prophylaxie pré-exposition (PrEP)
Dans ce domaine aussi, Rome a révélé de nouvelles données positives, issues de deux essais impliquant des couples hétérosexuels. Les données avaient été annoncées avant le congrès et les essais arrêtés prématurément en raison des résultats positifs. L’essai Partners a comparé le Ténofovir et le Ténofovir/FTC (Truvada) avec un placebo chez des couples sérodiscordants au Kenya et en Ouganda ; l’essai TDF2 a comparé le Truvada à un placebo chez des couples hétérosexuels au Botswana. L’essai Partners a démontré un effet protecteur de 62% pour le Ténofovir et de 73% pour le Truvada. Dans l’essai TDF2, l’effet protecteur du Truvada s’est élevé à 63% au total, mais à 78% chez les couples qui avaient pris des médicaments moins d’un mois auparavant. Cette circonstance met à nouveau en évidence le problème de la fidélité au traitement dans le cas de la PrEP.
Que signifient les données de Rome pour la prévention ?
Avant toute chose, que ce ne sera pas simple. Nous savons désormais que le démarrage précoce de la thérapie, l’utilisation de la PrEP et les microbicides vaginaux ont une influence sur les taux de transmission du VIH. Mais il ne suffit pas de prouver l’efficacité d’une intervention donnée.
Il faut comprendre pourquoi certaines interventions fonctionnent dans certains groupes à risque et d’autres non (certains résultats sont contradictoires ou ambigus). Il faut comprendre les caractéristiques spécifiques des réseaux sexuels, des comportements sexuels et l’épidémiologie locale, car ces paramètres influent sur l’efficacité des interventions. Et il faut en particulier comparer l’efficacité d’une intervention isolée avec l’utilisation combinée d’un ensemble de mesures préventives.
Il n’y aura probablement pas d’intervention individuelle « la meilleure » ou « la plus efficace », mais plutôt un ensemble d’interventions spécifiquement adapté à un groupe à risque. Nous avons donc besoin d’essais locaux supplémentaires portant sur ces composants et leur implémentation. Enfin, il nous faut aussi tout simplement savoir « à quoi ça sert et combien ça coûte ».
100 à 150 infections évitées chez les MSM en Suisse, c’est une économie de plus de 2 à 3 millions de francs, et ces chiffres se cumulent d’année en année. Au vu des chiffres suisses et des données de Rome, cet objectif semble réaliste. La réalisation de l’objectif dépend du développement d’essais adaptés, d’une meilleure surveillance, d’une amélioration de la collaboration interdisciplinaire entre les autorités, le corps médical, les chercheurs, les auxiliaires SIDA et les intéressés, et enfin de l’élaboration de modèles épidémiologiques les plus réalistes possible.
Il faut à présent beaucoup réfléchir, bien planifier et coordonner au mieux les acteurs, sans brûler les étapes. Il faut aussi ramasser en premier les fruits les plus éloignés, c’est-à-dire identifier en Suisse les 35% de patients atteints du VIH qui se présentent aujourd’hui tardivement dans les hôpitaux sans avoir été diagnostiqués, et aussi identifier les sujets primoinfectés au VIH, les conseiller et les soigner.
Texte : David H.-U. Haerry
L’auteur remercie le Pr Pietro Vernazza de l’hôpital cantonal de Saint-Gall pour la relecture du manuscrit.
- Détails
- Catégorie : Études
Dans la majorité des pays, le don d’organe n’est pas ouvert aux personnes séropositives. La législation a été modifiée en Suisse en 2007. Pour la première fois à Genève, il a été transplanté à un patient séropositif le foie d’un donneur lui aussi séropositif. Donneur et receveur étaient sous traitement depuis plusieurs années et tous deux présentaient des résistances multiples, documentées mais contrôlées. Cinq mois après l’intervention, le receveur se porte bien. Le don d’organe entre personnes séropositives est donc possible.
Le don d’organe de personnes séropositives est interdit dans la plupart des pays du fait des nombreuses inquiétudes qu’il suscite. Aux USA seuls, cette interdiction implique la perte annuelle d’environ 350 dons d’organes. Les patients séropositifs en attente d’un nouvel organe sont de fait discriminés sur les listes d’attente. Le risque de décès des receveurs séropositifs est donc plus élevé – notamment chez les patients présentant une co-infection à l’hépatite C. Cette interdiction de transplanter un organe séropositif se base sur la supposition que la transplantation d’organe d’un donneur séropositif à un receveur séropositif génère la transmission d’un autre type de VIH qui ne pourrait plus être contrôlé chez le receveur. Il pourrait en résulter chez ce dernier une surcharge du système immunitaire, se traduisant par le développement possible de ce que l’on nomme des infections opportunistes.
Jusqu’ici, la transplantation rénale de donneurs séropositifs à des receveurs séropositifs n’avait été effectuée qu’en Afrique du Sud. Les donneurs n’avaient soit encore reçu aucun traitement, soit encore jamais été changés de traitement. Aux USA, de telles transplantations sont légalement possibles depuis 2013, mais leur réalisation nécessite un protocole de recherche approuvé, soit une inutile barrière supplémentaire. En Suisse, 569 personnes séropositives sont décédées entre 2008 et 2014, dont près de 80 pour cause d’insuffisance hépatique. Dans le même intervalle de temps, 14 personnes séropositives ont reçu le foie d’un sujet séronégatif. Le présent article traite de la première transplantation hépatique entre un donneur et un receveur tous deux séropositifs.
Donneur et receveur
Il a été proposé à un homme séropositif de 53 ans le foie d’un donneur décédé en octobre 2015. Le receveur, séropositif depuis 1987, a contracté l’infection par la consommation de drogue. Il a en outre été diagnostiqué en 1997chez le receveur une hépatite C dont il a guéri spontanément, sans traitement, en 2004. Il avait de même contracté auparavant une hépatite B dont il avait aussi guéri de manière spontanée. En 2011, on lui diagnostique une hépatite D à un stade avancé. Elle est traitée par interféron-a pégylé, traitement toutefois mal supporté par le patient. Le receveur était depuis novembre 2014 sur la liste d’attente pour une greffe du foie. Son état subit une aggravation importante au cours de l’été 2015.
Le donneur était un homme de 75 ans décédé d’une hémorragie cérébrale. Bisexuel, il avait été diagnostiqué séropositif en 1989. Donneur et receveur avaient développé des résistances suite à des traitements préalables. Ils avaient toutefois été traités avec succès et leur charge virale était tombée sous le seuil de détection. Les CD4 oscillaient chez le receveur entre 300 et 400 cellules par microlitre, et se situaient chez le donneur à 298 cellules par µl au moment du décès. Le donneur, informé par son médecin de la possibilité de faire un don d’organe, a établi un consentement écrit en septembre 2015. Les résistances étaient documentées pour chacun des deux patients. Le receveur a été informé avant l’intervention des résistances du donneur et du changement de traitement impliqué. Il a donc accepté le risque et signé une décharge écrite.
Intervention et traitement subséquent
Le foie transplanté a fonctionné de façon normale tout de suite après l‘intervention. Il était repris deux jours après la transplantation une thérapie antirétrovirale. Au traitement de base par rilpivirine/ténofovir/emtricitabine ont été rajoutés le raltégravir et l’enfuvirtide. D’autres médicaments post-transplantation ont également été administrés. Le traitement anti VIH a été à nouveau simplifié trois mois après l’intervention.
Conclusions et commentaire
La transplantation réussie du foie d’un donneur séropositif à un receveur séropositif est une révolution à de nombreux niveaux. Il n’avait jusqu’ici été réalisé que 27 transplantations rénales à des receveurs séropositifs en Afrique du Sud. Et ce, avec un taux de succès similaire à celui observé chez les receveurs séronégatifs. Dans le cas de la transplantation effectuée à Genève, donneur et receveur étaient tous deux séropositifs depuis env. 30 ans, avec derrière eux déjà plusieurs changements de traitement, et des profils de résistances différents. D’où un renforcement important du traitement anti-VIH chez le receveur après l’intervention – pour lequel l’enfuvirtide (Fuzeon) oubliée a même été ressortie des tiroirs. Cinq mois après l’intervention, le patient se porte bien. Et la triple infection hépatique n’a pas non plus eu d’impact négatif.
Malgré son succès, ce type d’intervention reste un défi. Les interactions médicamenteuses et les contrôles immunologique et virologique peuvent être sources de problèmes et les antécédents médicaux du donneur comme du receveur doivent être connus dans les moindres détails. Cet article se veut également une incitation aux personnes séropositives à établir un consentement de don d’organe lors d’une prochaine consultation médicale. Vous aussi, vous pouvez sauver des vies!
David Haerry / Octobre 2016
1 Alexandra Calmy et al, Swiss HIV and Swiss Transplant Cohort Studies, American Journal of Transplantation 2016; XX: 1–6, doi: 10.1111/ajt.13824
Page 3 sur 8